Roman que je suis en train d’écrire, il y a environ 250 pages pour l’instant ( dont plus d’une centaine des souvenirs d’enfance écrites par mon père dans un ouvrage...)
CHAPITRE I
Retour vers le passé
Cette histoire, ce roman d’anticipation que vous vous apprêtez à lire, est un récit traversant les époques, des mondes, des univers réels et imaginaires. Vous allez voyager dans le passé et dans un futur très lointain.
Les deux parties, “U MOCU NERU” et “A ROCCA BIANCA” , écrites par François Canonici, traitent des souvenirs réels d’un petit garçon, ainsi que des grandes lignes d’une saga familiale se déroulant au vingtième siècle, en Corse, entre Figari et Bonifacio. Ces deux parties ont été écrites antérieurement au roman que vous avez dans les mains, si je les ai insérées dans l’histoire (dans une version résumée et sans ses nombreuses illustrations), de la manière la plus cohérente possible, c’est pour leurs qualités littéraires et émotionnelles, c’est aussi pour le précieux témoignage du quotidien des gens simples de cette époque...
~~~~
Vingt et unième siècle, 2020, Antoine (appelé communément Anto), est commerçant saisonnier, il a trente cinq ans et vit dans l’extrême sud de la Corse avec Marie, sa femme, infirmière à l’hôpital local de Bonifacio, et leurs deux enfants de six et huit ans, Davia et Lisandru.
Ils possèdent une maison de campagne sur un plateau calcaire bordé de vieux murs en pierres sèches, une propriété très arborée avec des oliviers centenaires, des chênes verts, des chênes-lièges, des arbousiers, des figuiers...
Depuis deux mois, Anto a fermé son commerce de souvenirs (artisanat local), il pratique depuis son travail hivernal, celui lui convenant le mieux, bûcheron. Il aime travailler seul, couper du bois, brûler les branchages et voir s’élever des tourbillons d’étincelles, cela répond à son désir d’être en pleine nature, à son besoin de se dépenser physiquement, de refaire le monde dans sa tête.
Le couple traverse aujourd’hui une période apaisée, les enfants sont scolarisés et épanouis, tous leurs projets sont réalisables à moyen terme...
Anto est mort de vieillesse en 2079, à l’âge de quatre vingt-quatorze ans.
Mais pour l’heure, revenons au présent...
Anto est vaseux, fiévreux, une migraine tenace le maintien allongé dans le noir profond.
Ses obsessions matinales le font divaguer, ses pensées se bousculent, ses souvenirs d’enfance les plus flous défilent et s’éclaircissent, ils l’emmènent loin, il s’entend se rappeler dans son for intérieur...
...D'aussi loin que je me souvienne...je n’étais pas plus haut qu’un tabouret, je revois une large cuve de gaz, antre d'un ogre indescriptible, la pire des races. Une petite fille laisse remonter une fourmi dans son filet de morve. Des collines violettes surplombent la cour d'école. Je porte un masque de la bande des aristochats. Il ne masque que partiellement mes angoisses. Se mettre dans le rang et donner la main pour entrer dans ce bâtiment rectangulaire me provoque des nœuds aux ventre, et je n'ai même pas idée de l'existence de l’esclavage. Et puis, il y a cette tour génoise, sur la plage, même par temps gris les galets brillent. Ça donne envie, comme la poire du Pinocchio de Comencini. Une fenêtre donne sur des arbres en fleurs. À la station-service, un dauphin en mousse compacte et des brassards sentent le plastique de plage.
Le rêve peut vous cueillir. Pleurer en voyant une chanteuse chanter en pleurant. Sous d'autres latitudes, je revois dans la nuit noire le reflet lumineux d'un lampadaire sur les pavés génois mouillés de la ruelle.
Une silhouette sombre portant un chapeau et une longue gabardine disparaît dans l'insondable.
C'est un ancien inspecteur de police...me dit mon père.
Le meilleur roman noir de ma vie.
La littérature se lit parfois dans les courants d'air.
Puis, les choses s'accumulent, les repas avec plusieurs viandes, le vélo dans la terre mouillée, c'est beau l'innocence, des efforts en vain et dans les rires.
De l'eau qui se déverse en millions de mètres cubes, sans jamais étancher une soif, des mots écrits pour rien, tout se gaspille.
La logique crue surgit de n'importe où, je regardais ce poisson rouge slalomer entre les nénuphars en fleurs, des roseaux reliaient le bassin aux fluides fuyants. De petites grenouilles, plus vertes que dans les livres d'école, croassaient sans souhaits apparents. Moi, à l'ombre de cette forêt de tournesols géants en ordre anarchique, j'imaginais qu'en cet instant des enfants perdaient leurs parents.
J'étouffais en pensant aux gens dans les caveaux étroits.
La voisine, une petite vieille coquette, nous recevait le samedi soir.
Avant d'arriver devant le petit écran couleur ; alors que nous ne connaissions que le noir et blanc; ce long couloir, des bibelots lustrés, le bouddha ventru qui souriait toujours plus, nous allions voir “Chapeau melon et bottes de cuir”...
Puis, l'on apprend sur la vieillesse et le dégât des os...
Des instants d'éternité, mais le temps ne se fige pas...
Il en reste des ressentis de plus en plus flous.
Un jour, malgré ( grâce à) mes illusions fanées, je me mis à écrire.
Peut-on écrire quand on a pas mal ?
Je ne crois pas...
Écrire comme mettre un pansement sur une blessure invisible, passer la deuxième couche avant la première, vomir sur tout, pisser sur des mantes religieuses, couper des cordons avec ce bruit de carton, admirer le travail des pourris, s'éloigner de la pub, faire des ronds carrés, des pics de douceur, du poivre en lévitation, des cheveux sortis du siphon, les faire bouffer aux pompeux, raboter des condescendants jusqu'à la moelle osseuse, donner la parole aux muets, la vue aux aveugles, des vulves pleines de con-passion aux vieux puceaux, des nazis jouant à la Barbie, des rabbins bouffant des hosties, des salafistes en tutus, des singes aux affaires, des noms aux oiseaux que l'on regarde sans voir, des gâteaux à la boue, des levers de soleil, des mots nouveaux...
Se donner l'illusion que l'esprit occupe le corps, estomper ses démons, alléger le poids de sa croix, ne plus boire son sang, écrire avec.
Cela nourrit les illusions qui ne disent pas leurs noms.
J'en souffre, de cette rue disparue ; en bas, il y avait la marchande de vin, des tonneaux, des bonbonnes, des bouteilles consignées - et cette odeur - plus haut, l'épicière et les anchois dans le tonneau - pas des anchois des tropiques, il aurait fallut attendre qu'ils mûrissent - derrière les olives, des saucissons, des fromages secs ou humides - devant, des escargots dégorgent.
Plus haut, la mercerie, la laine Pinguin, les boutons, les cordons, les scoubidous...
Les pêcheurs avaient des gueules de soleil, des filets étalés sur les quais - c'était le temps où l'homo du village était respecté, les grands vantaient sa discrétion et son honnêteté, les petits lui achetaient jouets et bonbons...
C'était le temps des crèches vivantes, des ressources inattendues, d'un parrain revenu de nulle part après un tour de chant - c'était le temps des roseaux dans la ville, des ânes portant le bois, du clocher rénové du curé en soutane - le poivrot jardinier était un philosophe - c'était le temps où le coiffeur écrivait sur une affiche : Fermé pour cause d'ouverture...
Il songe maintenant à ces ahuris agglutinés devant les yachts, au Quai d’Honneur, il ne manque plus que des bataillons d’asiatiques masqués en rangs serrés derrière des drapeaux rouges - ça l’agace, voir des déclassés en villégiature donnant de l’importance à des milliardaires sirotant négligemment du champagne...négligemment, pense t’il, tel un chat, patte arrière tendue, se léchant consciencieusement le pourtour de l’anus.
L’ambiance en Corse lui paraît de plus en plus bizarre et malsaine, oscillant entre assassinats, Vip liftés et rapports creux, racket institutionnalisé, consumérisme frôlant la zombification - de cohortes de véreux en bataillons de vénaux - des rapports édulcorés, du nustrale en plastique, des bijoux en toc, des faciès peints aux sticks, du tout tourisme en stock, des villas en kit, des immeubles en blocs - avec la privatisation d’écrins pour les uns, la paupérisation pour la plupart des autres...
Ses pensées font contre poids avec sa lecture de la veille au soir. Un ouvrage, écrit par son père, retraçant une part de la saga familiale dont il a découvert des pans entiers, il en est tout chamboulé...
C’était comme ça...
L’histoire commence tout au sud de la Corse, autour du petit village de Figari.
Les événements qui suivent sont réels et retracent, le plus fidèlement possible, une époque révolue.
À partir de maintenant, vous allez effectuer une première plongée au cœur du passé...
Extrait...
C’est par un beau jour de septembre que les deux amoureux, suivant leur âne chargé de quelques provisions, empruntèrent un sentier embaumé de toutes les effluves du maquis, menant vers un mont assez élevé, couvert de bois de chênes et d’arbousiers, où se trouvait une belle grotte, una sapara C’est là que les deux tourtereaux s’apprêtaient à vivre sans doute les plus belles heures de leur vie amoureuse.
François, qui avait tout prévu quelques semaines auparavant, avait « meublé » sommairement l’endroit. C’est-à-dire qu’il avait installé deux caisses en bois en guise de chaises, une table faite de planches de récupération, dont d’autres servaient de « sommier » , surélevées sur deux rangées de pierres, où était posé le matelas composé de quelques sacs en toile de jute cousus et bourrés de feuilles sèches de maïs. Il avait aussi amené deux casseroles (une grande et une petite), une poêle à frire, deux assiettes, deux bols, deux verres et quelques denrées, car on ne pouvait tout de même pas vivre que d’amour et d’eau fraîche. Le feu était allumé entre deux gros cailloux.
C’était un très bel abri pour des amoureux. Calme et retiré. La nuit, son entrée était fermée par des branchages bien fournis. La pluie pouvait toujours tomber, la grotte était parfaitement abritée et étonnamment dépourvue de la moindre humidité. Certes il faisait encore un peu froid la nuit. Mais on allumait du feu et on se serrait l’un contre l’autre.
Puis, heureux et confiants, les deux amoureux s’endormaient, bercés par les chants di « i griddi sittimbrini » (les grillons de septembre).dont les stridulations régulières et apaisantes montaient vers le ciel étoilé.
Le jour, mon père allait tranquillement accomplir les travaux pour lesquels il était payé. Au village, il passait voir sa mère et Marcelle, sa fille, pour l’embrasser et la tranquilliser.
« O Francè, quantu a da durà stà vita di vagabondu ? » ne manquait pas de lui dire sa mère Zia Tiresa. (« François, combien va encore durer cette vie de vagabond ?»). Réponse de mon père qui vouvoyait Zia Tiresa (cela se faisait beaucoup à l’époque) : « Prestu, o Mà, prestu, un v’ inquieteti » (Bientôt, maman, bientôt, ne vous inquiétez pas ».
Puis, ayant chargé son âne de bidons d’eau et de quelques vivres, il regagnait la montagne voisine, heureux et pressé de retrouver sa Virginie qui l’attendait avec l’impatience qu’on imagine.
Combien de temps les deux amoureux vécurent-ils dans cette grotte ? Je l’ignore, mais c’est certainement dans ce modeste endroit, digne de l’habitat de nos plus lointains ancêtres, que devait être conçu mon frère aîné, Don Quilicus (Lulu). Ce dernier aurait d’ailleurs pu y naître, comme le petit Jésus dans la grotte de Bethléem ! En effet, depuis quelque temps, Virginie commençait à marcher penchée en arrière et son ventre s’arrondissait petit à petit. Alors, le couple jugea plus prudent et raisonnable de retourner au village pour vivre dans une vraie maison. C’est-à-dire celle de Zia Tiresa qui, de plus, était…accoucheuse ! C’est d’ailleurs elle qui, quelques mois après, devait aider Virginie à mettre au monde son premier enfant : Don Quilicus !...
.....Cette fois, c’était bien vrai, nous quittions Figari. Définitivement. Un dernier regard vers « a casa di Chjirulettu » qui semblait si triste elle-aussi ; un autre vers le « bonhomme » de Georgeville, comme d’habitude imperturbable et indifférent, et le camion démarra. Il traversa Tivareddu puis Caravonu. Tout le long du parcours, mes parents faisaient des signes « d’au-revoir » à des villageois qui leur répondaient en agitant les bras. Au croisement de Scopettu, le véhicule vira à gauche, vers le Sud. Peu après, il s’engagea lentement, prudemment, sur le pont de Ventilegne alors revêtu de planches disjointes et gémissantes. Je ne m’étais pas endormi. J’ouvrais au contraire tout grand mes yeux sur le paysage un peu désolé qui défilait entre le pont et la Trinité. A présent le camion gravissait, en chantant une autre mélodie, le col d’Arbia.
C’est alors qu’au loin m’apparut une sorte d’immense bateau blanc hérissé de tours, de maisons, de clochers, de murailles et de bastions : « Tu vois, François, c’est Bonifacio, là-bas ! » me dit joyeusement ma mère en m’embrassant.
Il commençait à faire un peu sombre. Plus loin encore, j’apercevais d’étranges faisceaux lumineux qui balayaient la côte et la mer, tournaient, puis disparaissaient un court instant pour réapparaître encore et recommencer leur manège, inlassablement. Mais qui était donc ce géant qui projetait de si puissantes torches ?
...
Dans le futur..
Artz m’apprend que les gardes en faction devant le grand sas d’entrée sont des robots humanoïdes post quatrième guerre mondiale, ils paraissent plus humains que les citoyens ordinaires.
L’un des garde vient scanner la rétine d’Artz, le sas s’ouvre...
Le long couloir aux fumées bleutées, paraît être façonné dans un nuage. Au bout du couloir, j’entre directement en contact avec l’invraisemblable, dans une salle aux couleurs crépusculaires, des centaines de corps nus suspendus dans les airs, ils sont sous brumisation permanente en basse pression, leurs cerveaux baignent dans des récipients au-dessus de leurs têtes. Un système neuro artificiel relie tous ces “humains méduses”, il permet de réguler l’ensemble de leurs organes, d’effectuer toutes leurs fonctions inconscientes, et de leur ôter toutes fonctions conscientes, comme la prise de décision.
Je ressens un sentiment étrange, dérangeant, c’est bizarre car j’ai l’impression d’être déjà venu dans ce lieu...
Toute cette chair blanche, ils forment une guirlande d’hommes et de femmes aux yeux vitreux, c’est morbide. Certains corps sont balafrés à plusieurs endroits, des organes leurs ont été prélevés, ces derniers se reconstituent encore et encore.
Ils ont des sondes à tous les orifices pour la nourriture, l’eau, les déjections...
Des veaux, les humains comme du bétails, ceux-là et ceux de l’extérieur.
Je pensais souvent ça dans mon autre vie, mais j’y avais l’essentiel, mes enfants, ma femme, ma famille, mes potes.
Je ressors profondément perturbé, je m’en vais me taper un cul au temple, pour faire le vide...
...Je remonte vers la haute ville, et là...je n’en reviens pas, dans la grimpette pavée de pierres calcaire, un vieil homme sur un âne, des deux côtés du baudet un fagot de bois, à l’arrière, un grand panier en osier solidement fixé, rempli de fruits et de légumes.
Quand il arrive à ma hauteur, je lui dis bonjour en Corse...
— Bonghjornu...me répond-il
Il se nomme Monsieur Joseph, il me demande mon nom, d’où je viens, j’éprouve une grande émotion à parler à un ancien, quand j’étais enfant, il y en avait encore quelques-uns de ces personnages attachants, mystérieux, humbles, détenteurs d’inestimables savoirs.
Je suis à l’aise en sa présence, ne ressens pas de désordre émotif, n’éprouve aucun besoin d’en rajouter pour prouver je ne sais quoi.
Je n’ai pas envie de lui faire part d’une réalité qui, à mon sens, le dépasse, et de toutes façons lui déplairait tant elle est éloignée de son mode de vie simple.
Je me contente de lui dire que je viens du dernier Continent habité, que si j’ai des origines corses, c’est la première fois que j’y viens.
Il sourit, regarde ailleurs, prend l’air un peu gêné qu’ont souvent les gens humbles qui se sous-estiment, ces gens qui ne sont pas frustrés par ce qu’ils n’ont pas...ça faisait pourtant bien longtemps que je n’avais pas admiré et estimé quelqu’un de la sorte.
C’est moi qui me sens petit devant lui et son univers.
Il me fait penser à certains anciens, des gens de la terre touche à tout, j’en voyais souvent étant enfant, qu’ils soient de la famille ou d’ailleurs, ils avaient toujours quelque chose à faire, arranger un hangar, clôturer, tuer un cochon, charcuter, semer, planter, récolter, s’occuper de la vigne, vendanger, démaquiser, ouvrir un sentier, remonter un mur en pierres...si cela n’était pas la liberté, alors, je fais l’éloge de la contrainte.
C’est sans doute ce que j’ai ressenti comme se rapprochant le plus de de la liberté...avec des travailleurs souvent propriétaires de leur outil de travail, aussi humble était-il.
Pas comme ces emplois qui pullulaient alors, ils étaient dénués de sens et d’utilité, les bullshit jobs (merdes de taureaux).
Un grand nombre de personnes savaient que leur métier ne servait à rien, voir qu’il était nuisible, il y en avait des « jobs à la con » ...consultants en ressources humaines, coordinateurs en communication, chercheurs en relations publiques, stratégistes financiers, avocats d’affaires... » que de la merde...
Je passe les portes du pont-levis, plusieurs commerces sont ouverts en Haute-Ville, je croise une vieille dame portant le foulard, je la salue, cela me fait penser un instant aux incessants débats télévisés à propos du port du voile, je reviens aussitôt m’ancrer dans la merveilleuse réalité que je vis, elle me répond avec un sourire discret. Des enfants jouent au ballon sur la place de la loggia, devant l’église Sainte-Marie-Majeure...exactement comme nous le faisions.
Rien n’a vraiment changé, si ce n’est que tout est encore plus beau, tout est semblable à l’environnement des années soixante (1960), voitures, boutiques, vêtements ; mais, visiblement, il y a bien plus d’opulence...
De jeunes et jolies femmes, portant d’élégants chapeaux, se promènent dans les ruelles étroites, regardent les devantures des boutiques, avant de rejoindre d’autres jeunes gens au centre d’une place ensoleillée...
Tout est un enchantement pour moi, une charrette pleine de jarres à huile d’olives traverse la rue, il y a bon nombre d’étals de fruits et de légumes fraîchement cueillis dans les jardins bonifaciens, des boucheries proposant viandes et charcuteries d’éleveurs locaux, cochons, cabris, agneaux, bœuf, poulets...
Un petit garçon pose sa caisse pleine de bouteilles vides en verre, réajuste ses bretelles, puis, entre dans le magasin du marchand de vin, l’odeur de raisin fermenté embaume agréablement, le marchand ouvre le robinet d’un tonneau et remplît consciencieusement toutes les bouteilles.
Il me fait signe de venir boire un verre, son commerce est au-dessous de la maison où je suis né.
Nous trinquons, il me souhaite la bienvenue et me propose les clés d’un appartement rue Doria.
— A saluta
Il me parle de ses vignes situées sur les plateaux calcaire de Parmentile, un secteur où se trouvaient le terrain familial où j’ai longtemps vécu.
Plus tard, je descends à la marine, le port est superbe, il n’y a plus de terrasses de restaurants et de bars occupant les deux côtés de la voie de circulation, seulement quelques tables et chaises côté habitations, j’ai une vision dégagée et profonde sur le goulet, sur le plan d’eau flottent uniquement de superbes bateaux de pêche aux couleurs vives.
Sur le quai, des pêcheurs réparent leurs filets, plus loin, sous les palmiers, des joueurs de pétanque font une partie animée.
J’entre dans une boulangerie près de l’église Saint-Erasme, demande un pain des morts, la boulangère me l’offre avec le sourire.
L’appartement Rue Doria est tel qu’il était il y a des milliers d’années, d’abord, il faut monter les marches en pente abrupte dans l’étroit couloir, j’ouvre la porte en bois, au sol, des tomettes en terre cuite, les murs sont enduits de crépi fin au sable calcaire de Bonifacio, mélangé à du ciment blanc et à de la chaux, les meubles sont en bois massif, piqués, ça sent bon la cire et le vieux bois, je vais sur la petite terrasse du salon, elle est perchée à quatre vingt mètres au-dessus de la mer, au loin, je ne vois pas les côtes sardes.
Un voisin me propose les clés d’une 4L, un bonheur de voir d’anciennes voitures, j’appelle Artz avec un téléphone noir à cadran, en Bakélite, il loge dans un appartement sur le port côté Solemare, je vais le chercher pour aller faire une oursinade, nous partons vers la Testatella, au nord-ouest de la ville, nous arrivons au-dessus d’une crique aux fonds rocheux, on n’a qu’à se pencher et à les décrocher avec un poignard, nous posons plusieurs douzaines sur un grand rocher lisse et plat, je décroche quelques arapèdes avec, la bouteille de vin blanc est calée dans l’eau, nous ouvrons les oursins à l’aide de ciseaux.
J’ai un grand sentiment de liberté, à mon époque, tout était limité, quantifié, ou interdit, comme le prélèvement d’arapèdes, il y a des paradoxes surréalistes, tout fait sans doute partie de cycles sans cesse renouvelés, la nature se réalise inlassablement, implacablement, l’homme croit maîtriser ces cycles, il n’en est rien...
Artz m’observe puis les mange comme moi, à la bonifacienne, il secoue l’oursin tête en bas pour vider les éclats de coquilles et autres épines, puis récolte le corail avec le pain. Nous nous régalons, le mariage de douceur sucrée iodée est incroyable, je regarde les ridules sur l’eau translucide et dis
— C’est ça la vie...
— C’est vrai...répond Artz, visiblement touché par la simplicité et l’authenticité de cette communion avec la nature
Je lui montre un rocher, au loin, dressé sur sa montagne et
défiant les lois de l’équilibre, l’Omu Di Cagna, je lui récite une poésie que j’ai retenu de ma vie antérieure
L'OMU DI CAGNA
Depuis la nuit des temps, sentinelle dressée
Défiant les quatre vents et les cieux courroucés
Les échos de fureur de sa terre souillée
Volutes de fumée du maquis qu'il domine
De ces envahisseurs qui transpercent la chair
Des enfants qu'ils arrachent à l'amour de leurs mères
Un peuple dont l'honneur fut lavé par le sang
De ces âmes perdues de n'avoir pas trouvé
L'harmonie d'une terre, une vie apaisée
Les ciels qui défilent, les effluves de myrte
La rivière lointaine où ondule une truite
Les côtes où le ressac a des relents de poudre
Fier dans la tempête, insensible
à la foudre
Forteresse incarnée, il est la clé de voûte
Du passé au présent conjugué au futur
De ces lopins de terre que l'on donne en pâture
Aux appétits féroces de ces spéculateurs
Qui brisent l'équilibre et arrachent le cœur
De ces âmes perdues qui survolent les monts
Les criques cristallines, les troupeaux, les églises
Les sources millénaires, les voix qui cristallisent
La plainte des nations, la lueur d'une flamme
Les chants qui montent aux cieux pour l'amour d'une femme
Toi le témoin du temps, droit, fier, l'Omu Di Cagna
.... ...Rien ne tient plus dans la structure des hommes, tout a été scié entre deux planches, la colonne séparée de la tête, celle-ci bafouille encore, les hommes tiennent mal...ça c’est bien aggravé, ils avaient cassé les pattes aux chiens qui les suivaient avec affection, sans arrières pensées, toujours fidèles qu’ils étaient...
J’ai filé des temps interminables, et pourtant, le temps a passé puisque je l’écris maintenant...à l’approche de l’heure, c’est inéluctable - ça vous colle comme une mauvaise glaise sur la peau le mal que vous avez fait. Je vois les revenants ayant vécu ici, ils étaient dans ces contrées il y à des millénaires, c’était avant le temps maudit où l’on ne put plus acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom en puce sous-cutanée...j’ai découvert ici ce qui était bon et m’amenait à de la sérénité - marcher dans la nature, sentir l’air pur sur mon visage, les odeurs de genêt, de romarin, de ciste...voir au loin se confondre le bleu du ciel et celui de la mer...désormais, je suis ancré dans la loi, non pas celle gravée dans la pierre, celle qui se fit chair dans le Cœur de Sa miséricorde...
...retranscription d’un récit que me fit un revenant
...un buffle rumine dans les hautes herbes, un voile brumeux et délicat dérive dans un souffle tiède.
Une fille aux longues nattes rejoint la maison de bambous sur pilotis au pied des rizières en terrasses.
Le soleil printanier détend mes muscles endoloris, le cri d’un oiseau bleuit l’air. Au détour d’un massif de plantes exotiques, un papillon multicolore sort de l'orbite d'un cadavre. Je lève la tête, la colline est rongée par le napalm.
On avait bien picolé la veille, des prisonniers étaient pendus par les pieds, nos alliés indochinois leur avaient ouvert l’abdomen, les avaient vidé puis avaient prélevé leurs foies et leurs cœurs pour en faire des brochettes, c’était leur tradition “pour prendre leur force” qu’ils disaient ; les barbecues exhalaient une excellente odeur de grillé, les rasades d’eau-de-vie de riz nous rendaient hilares à pisser en mangeant...
Son histoire achevée, il s’adresse à moi
— Si tu peux me voir c’est que tu as développé le don, grâce à ta rédemption, ta repentance, par l’élévation de ta conscience tu peux communiquer avec nous. Il te reste à vivre pleinement ton initiation pour arriver où tu dois.
Ton âme est rongée, en lambeaux, il convient que tu consacres le temps qu’il te reste à construire, à mettre en relief le beau, le juste, le vrai, et à transmettre...
Anto est curieux, il brûle les étapes et va lire dans la cage d’escaliers menant au grenier...
...Grâce aux revenants, je finis par développer une conscience aiguë des choses, une vision plus affinée sur le mal irréparable et sur le bien à réinventer. J’appris que le festin se mérite après plusieurs jours de diète, que la conversation brillante n’a lieu qu’après la méditation...
L’heure du tout tout de suite, du bling bling, du “Trop en faire”...est révolue. Mon désir de feu immédiat s’éteint, le réservoir est vide, le carburant à sec, la pédale est distendue. Mais ici, au cœur de la nature, j’entends chanter l’oiseau.
Comment leur faire mettre un genou à terre ? Comment mettre un bémol à l’ordre établi ? Comment les faire chuter du haut de leur morgue et de leur ignominie ?
J’étais des leurs, ma haine est d’autant plus
J’écris pour donner la matière pour les siècles à venir à celui qui fera la démarche initiatique de me lire, de me comprendre, et je l’espère sérieusement, mettra à profit mes conclusions pour changer ce monde.
...Anto ressent un intérêt de plus en plus fort à la lecture de l’incroyable témoignage de Conrad. Il le sait, cela représente quelque chose de capital, les éléments vont s’assembler pour constituer un puzzle qui l’éclairera. Tard dans la nuit, il rejoint Téxia dans le grand lit de leur chambre. Elle s’est endormie, nue, avec du verni à ongle et des paupières couleur or, il la trouve touchante maquillée pour la première fois de son existence, il ne peut s’empêcher de caresser sa peau de velours.
Roman d’anticipation
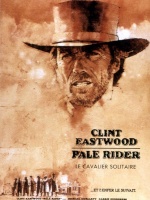
Hubert Canonici- Messages : 296
Date d'inscription : 01/03/2014
Age : 56
Localisation : Bonifacio
Autre extrait:
Anto écrit un journal intime, il y livre un témoignage sans concessions sur le monde passé et sur le présent. Artz lui a suggéré l’idée, en lui demandant, également, s’il pouvait témoigner de son vécu et de ses ressentis dans l’ancien monde...
...Je ne vais pas écrire ce journal avec la sincérité d’un politique, elle est du même tonneau que la virginité d’une pute...j’écris ici pour laisser un témoignage à qui pourrait en avoir l’utilité ou l’intérêt. Dans mon autre vie, j’écrivais parce que le Monde ne me convenait pas tel qu’il était, il y avait trop de gueules défaites, décomposées, huileuses, préfabriquées, contrefaites, ou même, contreplaquées. J’écrivais pour transformer, pour transposer, pour purger tout ça...dans l’écriture, comme dans les moments off de la vie, la relativité et le hasard se marient.
Il n’y a pas de ciel.
Cela fait des semaines que je suis né de nouveau dans cet étrange monde peuplé de cloportes sans âmes.
Je ne me sens pas vivant ici, pas banal pour un ressuscité ; ne pas pouvoir prendre ma femme dans mes bras, ne pas pouvoir rigoler et jouer avec mes enfants, ne pas pouvoir partager avec les gens que j’aime, ne pas respirer l’odeur du maquis, ne pas voir la mer et l’horizon. Moi qui appréciait la série “La quatrième dimension”, je suis en plein dedans.
Je suis chrétien, j’imagine que c’est obsolète aujourd’hui, je ne crois pas en la théorie de l’évolution de Darwin, malgré sa barbe blanche en pointe, imaginer un têtard devenant un nourrisson, issu de rien, se débrouiller seul pour se nourrir, survivre, abattre un mammouth, trouver une compagne et fonder une famille. Non, je crois à la création des espèces de manière distincte. Pour les humains, un homme et une femme dotés d’instinct, de libre arbitre, aptes à survivre, à procréer...la poule avant l’œuf...
Quand je vois où en est l’humanité je doute...puis je pense croire de nouveau...
La nature est trop bien faite pour que tout soit le fruit du hasard, de l’aléatoire. Pourquoi des oiseaux avec un cerveau de dix grammes volent sur des milliers de kilomètres au-dessus des mers en sachant où aller. Je vois ces oliviers, ces châtaigniers, ces fleurs sauvages...tout serait apparu du néant sans un coup de génie ?
Dans ce futur, les citoyens ordinaires ne vivent plus en famille ni en couple, l’individualisme est devenu la règle, la norme, ça ne change pas grand chose avec mon époque finalement. Ils ont juste perdu encore plus leur humanité, leur instinct.
Aussi factice qu’un parterre de miss qui sourient sans relâche et sans raison fondamentale, ils semblent avoir une IA (Intelligence Artificielle) stérile, ce sont des prolétaires tristement embourgeoisés, comme des épouvantails qui se chausseraient de souliers vernis...
J’ai croisé des “Sujets”, des êtres suffisants, plus grands que les citoyens ordinaires, ils sont généralement habillés de vêtements légers en lin blanc ou beige, comme dans les soirées blanches à la con que donnait Barclay, ou en combinaisons moulantes en cuir grises ou vertes, leurs regards sont plus brillants, certes, mais on y décrypte le mal et le mal-être, surtout chez les plus anciens.
J’ai découvert, ébahi, le temple des culs ( mis à disposition des citoyens ordinaires de sexe masculin ).
J’arrive devant un péristyle, une galerie de colonnes en or faisant le tour de l’édifice en dehors de son mur d’enceinte. En façade, des postérieurs féminins taillés dans un marbre au grain très fin et aux teintes délicates. J’entre par une des hautes portes en arcade, la salle est grande comme deux stades de football, une sorte de labyrinthe est matérialisé par des étoffes rouges et soyeuses formant une multitude de cabines.
J’écarte les étoffes et pénètre dans l’une d’entre elles...des culs offerts, des blancs laiteux, des noirs, des hâlés, des toniques et des flans, des croupes sorties d’écrins recouverts de velours couleur chair, c’est malsain, troublant et excitant, je sors de la cabine, des citoyens ordinaires déambulent avec des faces de pervers innocents.
Dans une autre cabine, un homme s’affaire sur un cul tel un pivert sur un tronc, il est raide des pieds à la tête et sautille sur la croupe jusqu’à décharger par saccades concentriques. Même en mesurant le pathétique de la situation, je suis pris d’une excitation prégnante et pars à la recherche d’un cul plus attirant qu’un autre...c’est insolite de ne pouvoir associer un visage à un cul, je passe des heures enivrantes dans ce palais...
Anto écrit un journal intime, il y livre un témoignage sans concessions sur le monde passé et sur le présent. Artz lui a suggéré l’idée, en lui demandant, également, s’il pouvait témoigner de son vécu et de ses ressentis dans l’ancien monde...
...Je ne vais pas écrire ce journal avec la sincérité d’un politique, elle est du même tonneau que la virginité d’une pute...j’écris ici pour laisser un témoignage à qui pourrait en avoir l’utilité ou l’intérêt. Dans mon autre vie, j’écrivais parce que le Monde ne me convenait pas tel qu’il était, il y avait trop de gueules défaites, décomposées, huileuses, préfabriquées, contrefaites, ou même, contreplaquées. J’écrivais pour transformer, pour transposer, pour purger tout ça...dans l’écriture, comme dans les moments off de la vie, la relativité et le hasard se marient.
Il n’y a pas de ciel.
Cela fait des semaines que je suis né de nouveau dans cet étrange monde peuplé de cloportes sans âmes.
Je ne me sens pas vivant ici, pas banal pour un ressuscité ; ne pas pouvoir prendre ma femme dans mes bras, ne pas pouvoir rigoler et jouer avec mes enfants, ne pas pouvoir partager avec les gens que j’aime, ne pas respirer l’odeur du maquis, ne pas voir la mer et l’horizon. Moi qui appréciait la série “La quatrième dimension”, je suis en plein dedans.
Je suis chrétien, j’imagine que c’est obsolète aujourd’hui, je ne crois pas en la théorie de l’évolution de Darwin, malgré sa barbe blanche en pointe, imaginer un têtard devenant un nourrisson, issu de rien, se débrouiller seul pour se nourrir, survivre, abattre un mammouth, trouver une compagne et fonder une famille. Non, je crois à la création des espèces de manière distincte. Pour les humains, un homme et une femme dotés d’instinct, de libre arbitre, aptes à survivre, à procréer...la poule avant l’œuf...
Quand je vois où en est l’humanité je doute...puis je pense croire de nouveau...
La nature est trop bien faite pour que tout soit le fruit du hasard, de l’aléatoire. Pourquoi des oiseaux avec un cerveau de dix grammes volent sur des milliers de kilomètres au-dessus des mers en sachant où aller. Je vois ces oliviers, ces châtaigniers, ces fleurs sauvages...tout serait apparu du néant sans un coup de génie ?
Dans ce futur, les citoyens ordinaires ne vivent plus en famille ni en couple, l’individualisme est devenu la règle, la norme, ça ne change pas grand chose avec mon époque finalement. Ils ont juste perdu encore plus leur humanité, leur instinct.
Aussi factice qu’un parterre de miss qui sourient sans relâche et sans raison fondamentale, ils semblent avoir une IA (Intelligence Artificielle) stérile, ce sont des prolétaires tristement embourgeoisés, comme des épouvantails qui se chausseraient de souliers vernis...
J’ai croisé des “Sujets”, des êtres suffisants, plus grands que les citoyens ordinaires, ils sont généralement habillés de vêtements légers en lin blanc ou beige, comme dans les soirées blanches à la con que donnait Barclay, ou en combinaisons moulantes en cuir grises ou vertes, leurs regards sont plus brillants, certes, mais on y décrypte le mal et le mal-être, surtout chez les plus anciens.
J’ai découvert, ébahi, le temple des culs ( mis à disposition des citoyens ordinaires de sexe masculin ).
J’arrive devant un péristyle, une galerie de colonnes en or faisant le tour de l’édifice en dehors de son mur d’enceinte. En façade, des postérieurs féminins taillés dans un marbre au grain très fin et aux teintes délicates. J’entre par une des hautes portes en arcade, la salle est grande comme deux stades de football, une sorte de labyrinthe est matérialisé par des étoffes rouges et soyeuses formant une multitude de cabines.
J’écarte les étoffes et pénètre dans l’une d’entre elles...des culs offerts, des blancs laiteux, des noirs, des hâlés, des toniques et des flans, des croupes sorties d’écrins recouverts de velours couleur chair, c’est malsain, troublant et excitant, je sors de la cabine, des citoyens ordinaires déambulent avec des faces de pervers innocents.
Dans une autre cabine, un homme s’affaire sur un cul tel un pivert sur un tronc, il est raide des pieds à la tête et sautille sur la croupe jusqu’à décharger par saccades concentriques. Même en mesurant le pathétique de la situation, je suis pris d’une excitation prégnante et pars à la recherche d’un cul plus attirant qu’un autre...c’est insolite de ne pouvoir associer un visage à un cul, je passe des heures enivrantes dans ce palais...
Ils marchent maintenant sur l’îlot d’or, arrivent dans l’espace réservé à Elliott, celui-ci ricane en boucle sur un écran où son image tressaute, son rictus satanique les fait tous tressaillir.
Une horreur pixelisée à jamais, un monde parallèle où est cristallisée l'image d’une souillure. Massod s’approche de l’écran et prononce clairement, et de manière très articulée, les prénoms d’Artz, d’Anto, de Téxia et de Vénia.
Les yeux d’Elliott deviennent blancs. L’air devient glacial. Son visage est encore plus démoniaque avec une bouche horrible et démesurée. Plusieurs voix, dont certaines très aiguës, d’autres graves et caverneuses, prononcent des incantations en diverses langues. L’odeur est nauséabonde, des algues et des plumes apparaissent autour de l’écran.
Le groupe est tétanisé.
L’écran devient noir, puis, ces mots en latin apparaissent :
Videbunt cadavera virorum qui prevaricati sunt in me, vermis eorum non morietur, et ignis eorum non extinguetur, et erunt usque ad satietatem visionis omni carni
Elliott réapparaît. Tous évitent de croiser son regard, comme s’ils craignaient d’être possédés pour l’éternité.
Des images défilent en vrac sur l’écran, il s’agit de certains de ses méfaits connus de tous, comme cette fois là où, enfant, il s’était fait fabriquer une poêle géante pour son anniversaire, avait obtenu l’autorisation de disposer de dix retraités. Avec un esprit pervers précoce, il avait échafaudé une ignominieuse idée...les citoyens sont euphoriques, ils sont enfin arrivés à la retraite et vont connaître un saut qualitatif important dans leur vie. Ils arrivent dans un lieu chatoyant par un moyen ludique, le toboggan, on leur a généreusement fourni des maillots de bain, ils atterrissent sur un espace parfaitement rond ceint par de hautes parois évasées. La surface est enduite de matière grasse, aussi, glissent-ils allongés sur le dos ou sur le ventre sur plusieurs mètres. Les retraités s’en donnent à cœur joie, s’amusent comme jamais, rient comme des gamins. On leur balance des légumes, de gros grains de sel, des épices colorés, ils n’avaient jamais vu ce genre d’aliments...la poêle géante repose sur d’énormes résistances, elle se met à chauffer, Elliott arrive en haut avec un sourire blanc, les retraités ne peuvent remonter, la matière grasse commence à cloquer.
Le visage déformé d’Elliott réapparaît, s’il essaie visiblement de parler, seul un serpent sort de sa bouche puis de l’écran, le groupe entier se replie vers l’arrière, le serpent rampe à une vitesse démente et disparaît.
Sur l’îlot d’or, les âmes stockées s’expriment en même temps, ça grésille, ça hurle, on entend des plaintes, des chuintements, certains et certaines vomissent leurs immondices hors des écrans.
Elliott s’approche
— Qui t’a fait subir l’euthanasie ?
L’écran d’Elliott s’éteint, tout autour, des arbres apparaissent avec des cicatrices purulentes sur les troncs. Leurs branches sont autant de bras décharnés. L’or a disparu pour se transformer en terre appauvrie, grisâtre.
Anto et Téxia roulent au cœur d’un cirque montagneux à perte de vue. Ils y a des vallées au sol d’argile, de sable, puis des terrains plats de sel.
Les montagnes en piles de roches s’élèvent au-dessus des vallées. Leurs versants sont ornés d’arbustes, d’herbes et de cactus. Seuls les pics et arêtes les plus élevés reçoivent assez d’humidité pour alimenter de petites forêts.
Dans ce désert orange écrasé de soleil, ils dévorent l’espace, la route est délicieusement désolée.
Une horreur pixelisée à jamais, un monde parallèle où est cristallisée l'image d’une souillure. Massod s’approche de l’écran et prononce clairement, et de manière très articulée, les prénoms d’Artz, d’Anto, de Téxia et de Vénia.
Les yeux d’Elliott deviennent blancs. L’air devient glacial. Son visage est encore plus démoniaque avec une bouche horrible et démesurée. Plusieurs voix, dont certaines très aiguës, d’autres graves et caverneuses, prononcent des incantations en diverses langues. L’odeur est nauséabonde, des algues et des plumes apparaissent autour de l’écran.
Le groupe est tétanisé.
L’écran devient noir, puis, ces mots en latin apparaissent :
Videbunt cadavera virorum qui prevaricati sunt in me, vermis eorum non morietur, et ignis eorum non extinguetur, et erunt usque ad satietatem visionis omni carni
Elliott réapparaît. Tous évitent de croiser son regard, comme s’ils craignaient d’être possédés pour l’éternité.
Des images défilent en vrac sur l’écran, il s’agit de certains de ses méfaits connus de tous, comme cette fois là où, enfant, il s’était fait fabriquer une poêle géante pour son anniversaire, avait obtenu l’autorisation de disposer de dix retraités. Avec un esprit pervers précoce, il avait échafaudé une ignominieuse idée...les citoyens sont euphoriques, ils sont enfin arrivés à la retraite et vont connaître un saut qualitatif important dans leur vie. Ils arrivent dans un lieu chatoyant par un moyen ludique, le toboggan, on leur a généreusement fourni des maillots de bain, ils atterrissent sur un espace parfaitement rond ceint par de hautes parois évasées. La surface est enduite de matière grasse, aussi, glissent-ils allongés sur le dos ou sur le ventre sur plusieurs mètres. Les retraités s’en donnent à cœur joie, s’amusent comme jamais, rient comme des gamins. On leur balance des légumes, de gros grains de sel, des épices colorés, ils n’avaient jamais vu ce genre d’aliments...la poêle géante repose sur d’énormes résistances, elle se met à chauffer, Elliott arrive en haut avec un sourire blanc, les retraités ne peuvent remonter, la matière grasse commence à cloquer.
Le visage déformé d’Elliott réapparaît, s’il essaie visiblement de parler, seul un serpent sort de sa bouche puis de l’écran, le groupe entier se replie vers l’arrière, le serpent rampe à une vitesse démente et disparaît.
Sur l’îlot d’or, les âmes stockées s’expriment en même temps, ça grésille, ça hurle, on entend des plaintes, des chuintements, certains et certaines vomissent leurs immondices hors des écrans.
Elliott s’approche
— Qui t’a fait subir l’euthanasie ?
L’écran d’Elliott s’éteint, tout autour, des arbres apparaissent avec des cicatrices purulentes sur les troncs. Leurs branches sont autant de bras décharnés. L’or a disparu pour se transformer en terre appauvrie, grisâtre.
Anto et Téxia roulent au cœur d’un cirque montagneux à perte de vue. Ils y a des vallées au sol d’argile, de sable, puis des terrains plats de sel.
Les montagnes en piles de roches s’élèvent au-dessus des vallées. Leurs versants sont ornés d’arbustes, d’herbes et de cactus. Seuls les pics et arêtes les plus élevés reçoivent assez d’humidité pour alimenter de petites forêts.
Dans ce désert orange écrasé de soleil, ils dévorent l’espace, la route est délicieusement désolée.
|
|
|



